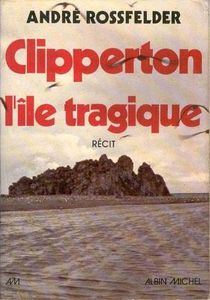Clipperton a fait une entrée fracassante dans l’univers des robinsonnades avec la diffusion des documentaires de Jean-Louis Etienne intitulés « Les mystères de Clipperton » (diffusé sur Canal+) et « L’atoll du bout du monde » (édité au Seuil). Pour être tout à fait juste, c’est l’encart intitulé « Les Robinson du Pacifique » dans les pages de Télé 7 Jours qui a piqué ma curiosité.
A vrai dire, l’expédition n’est pas elle-même une robinsonnade. Ce sont les archives de l’île qui recèle le secret des « Oubliés de Clipperton » : la tragédie d’une garnison mexicaine délaissée par son état major au cours des évènements révolutionnaires qui agitèrent le pays au début du 20ème siècle.
L’expédition de Jean Louis Etienne est une expédition naturaliste tout à fait banale. L’aventure manque du souffle homérique. On s’englue dans la gestion de projet, les financements, la logistique et le management. Le planning des scientifiques qui se succèdent est rébarbatif, le train-train quotidien sur le camp de base est soporifique, les soucis techniques de communication, d’intendance, de cuisine ou autres sont négligeables, la vie de famille déplacée et les petites touches d’éveil scientifique et de prise de conscience à l’écologie sont louables mais pas assez militantes à mon goût pour enfoncer le clou. Il faut voir ce que d’autres font quand même !
Et dire qu’on lui reproche d’être médiatique ! Loin s’en faut ! Pour ce qui concerne « l’entregent pour convaincre et trouver les financements ministériels comme les sponsors industriels […] pour monter une telle opération », j’en laisse juge le lecteur…J’espère par contre que les classes qui ont suivi l’expédition auront su tirer un meilleur profit de ce feuilleton scientifique. Pas sûr que l’Odyssée du Commandant Cousteau qui s’est arrêté 2 fois sur Clipperton, en 1976 et 1980, soit d’ailleurs beaucoup plus passionnante.
 |  |
Clipperton est tout juste une tête d’épingle au milieu du Pacifique à quelques 1 300 km (traduisez vous-même en mille marin) des côtes mexicaines. C’est une île basse corallienne, entourée d’un récif accore qui rend tout débarquement périlleux. A son extrémité sud-est pointe un rocher volcanique. Une dizaine de bosquets de cocotiers ponctuent l’île de verdure. Sinon elle est parfaitement désertique et soumise à des conditions climatiques éprouvantes. C’est le domaine exclusif de millions de crabes, de colonies d’oiseaux de mer (fous, frégates, sternes…), d’une espèce de lézard et de rats naufragés.
 |  |
C’est un îlot sur lequel la souveraineté de la France a longtemps été contestée. Découverte le vendredi saint 4 avril 1711 par Mathieu Martin de Chassiron et Michel Dubocage qui la baptise « Ile de la Passion ». L’île est rebaptisée Clipperton du nom d’un corsaire du roi Georges. Elle n’est revendiquée officiellement par la France qu’en 1858 par Le Coat de Kerveguen. Un imbroglio diplomatique oppose dès lors le Mexique qui estime que l’île appartient à l’héritage Espagnol et la France qui produit des documents officiels. Incapables de négocier une solution, les deux nations s’en remettent au jugement du roi d’Italie Victor Emmanuel III, jugement rendu seulement en faveur de la France en 1931.
Entre temps, nord-américains puis mexicains occupent et exploitent les gisements de phosphate de l’île. Les remuements de la révolution mexicaine puis de la Première Guerre mondiale ont toutefois fait oublier une garnison qui vivra ainsi en autarcie quelques années avant d’être décimée par le scorbut puis un naufrage malencontreux. Les quelques survivantes subiront les brimades du dernier soldat de la garnison, autoproclamé Roi de Clipperton, un véritable psychopathe.
La France reste très attachée à cette tête d’épingle qui lui ouvre une immense Zone Economique Exclusive. En effet, si l’atoll ne couvre qu’une superficie de 12 km carré, il confère à la France une souveraineté sur une zone marine de 435 600 Km carrés. Mais en l’absence d’une présence concrète cette souveraineté est bafouée !
La proposition de Jean-Louis Etienne de faire de Clipperton un « observatoire de l’océan » ressemble à une petite mort si l’on en croit ses détracteurs. Doit-on préserver à tout prix cet écosystème original voir originel au risque d’en faire un sanctuaire ? Bataille d’experts ! Querelles de personnes ! Le torchon brûle entre Jean-Louis Etienne et Christian Jost – chercheur au Cnrs qui mena lui-même deux expéditions en 1997 et 2001 – qui préconise, lui, de rouvrir les anciennes passes pour régénérer le lagon.
Quelle idée de vouloir préserver ainsi, et contre toute évolution, l’identité de l’île ? Clipperton déjà, les stigmates des activités humaines : exploitation des gisements de phosphate et base militaire américaines datant de la guerre du Pacifique et de la pollution charriée par les marées !
 |  |
 |  |
La garnison commandée par Ramon Arnaud notamment avait introduit des espèces végétales et animales étrangères qui ont changé un temps le paysage :
« A propos, les cochons, introduits en 1897 avec les deux premiers cocotiers par les futurs « oubliés » mexicains (l’île était un désert au 19ème siècle) ont en effet permis, par leurs déjections (dans lesquelles on retrouvait des carcasses de crabes, comme quoi il y a bien des lois naturelles inaliénables : rien ne se perd, aurait dit Lavoisier !), la fertilisation du sol corallien et la limitation des crabes, jusqu’à ce qu’une belle couverture végétale fasse tapis vert sur l’île.
Seulement, en 1958, les descendants de ces sympathiques porcins furent jugés, avec raison, espèces allochtone introduite, et donc bel et bien occis par les ornithologues de la Scripps Institution qui trouvèrent qu’ils dérangeaient par trop les oiseaux. Idées et théories d’une époque encore récente et de certains écologues qui considèrent toujours comme seul devenir possible le retour à l’état originel, ou le maintien à l’état dit « naturel » rousseauiste, si rare, voir inexistant de nos jours, même aux pôles. Il en est résulté une explosion de la population des crabes et des fous masqués s’accompagnant de la dégradation rapide de la couverture végétale et d’un retour à l’état désertique. »
Aujourd’hui c’est un tout autre nuisible que l’expédition tente d’éradiquer, Rattus rattus, le rat noir échoué sur l’île à l’occasion d’un naufrage récent et qui se développe rapidement au détriment des espèces indigènes. « Le rat noir est connu pour engendrer de nombreux dysfonctionnements dans les écosystèmes insulaires où il a été introduit. Diverses instances internationales ont émis des recommandations convergentes, dont la toute récente « Stratégie européenne relative aux espèces toxiques envahissantes », qui indique, entre autres, la tentative d’éradication de l’espèce chaque fois que cela est possible. Elle souligne aussi tout l’intérêt de procéder à cette à cette opération dès le diagnostic de l’invasion, afin de limiter le risque de modifications irréversibles. » Clipperton ne sera pas l’île d’Abel !
A quelque chose prêt, tous les romans réunis à ce sujet, constituent un ensemble assez homogène. Ramon Arnaud est peu ou prou assimilé à Giovanni Drogo, la garnison de Clipperton au fort Bastiani et l’océan au Désert des Tartares. Les 2 héros partagent les mêmes ambitions, les mêmes illusions, les mêmes déconvenues à ceci prêt que les auteurs spéculent sur l’incompétence, l’inconsistance, la vanité, le patriotisme tartuffesque, la folie de Ramon Arnaud.
Cette robinsonnade met en évidence les limites du génie humain. Dans des conditions extrêmes et hostiles, la nature est sans pitié. L’humanité est rétrogradée à sa capacité d’adaptation et l’homme à sa bestialité. Les notions de niche écologique et de chaîne alimentaire prennent alors tout leur sens. En écrivant cela je ne peux réprimer un petit sourire en repensant à une campagne de pub intitulée « Pour la réintroduction de l’homme dans la nature ». Ce gag soulève de vraies questions sur l’antagonisme nature Vs culture ! Le village, les installations agricoles et d’exploitation du phosphate ne sont qu’un mirage. Tout n’est que vanité – une expression qui raisonne comme un mantra -, la civilisation est liquidée en deux coups les gros et l’homme lui-même est en voie de disparition …
Mais comme si cela ne suffisait pas, le sordide reste à venir… La garnison est décimée en deux temps trois mouvements par le scorbut puis par l’engloutissement stupide d’une chaloupe conduite par un Ramon Arnaud en pleine confusion mentale, à la poursuite d’un navire croisant au large. Seul Alvarez, exilé dans son phare a échappé au naufrage. L’heure de la revanche a sonné. Il se proclame Roi de Clipperton et règne sur les femmes comme un pacha sur son harem, avec cynisme et brutalité. Il fait figure de psychopathe. Or tandis que l’univers du thriller produits des personnages toujours plus insensés, les auteurs ici semblent d’une parfaite mièvrerie même lorsqu’ils se libèrent du carcan de l’histoire pour écrire une œuvre romanesque. Certains auteurs poussent l’euphémisme jusqu’à réduire l’épisode à une peau de chagrin et à couvrir d’un voile pudique ses débordements. Mais les sources sont sommaires, alors qu’en penser ?
C’est une autre constante du corpus, les auteurs sont peu enclins à fantasmer, à improviser et même lorsqu’ils rebaptisent l’île et les personnages, ce n’est pas pour se laisser le champ libre mais pour s’enfermer dans leur pré-carré. Dommage, l’enchaînement des lectures manque un peu de relief. On scrute la moindre éminence, on creuse toutes anfractuosités, les aspérités du langage, les saillies du récit pour dénicher quelques impromptus qui seraient autant de perles d’un chapelet de variations. Mais non, on passe d’un récit à l’autre de façon monotone, austère, rébarbative presque. Après tout, n’est-ce pas un peu cela Clipperton ?
Moi aussi j’ai été pris de langueur. J’aurai voulu croiser les textes, arpenter l’histoire, signaler les points de vues, convoquer les personnages, faire preuve d’empathie …J’aurai pu. Avec un peu de courage ! Mais cent fois, pris d’une grande lassitude j’ai senti l’article me glisser entre les doigts comme une poignée de sable fin. D’autres projets, aussi, m’ont traversé l’esprit et ont balayé Clipperton, comme les rouleaux sur la barrière de corail, pour le rendre à la décrépitude des archives. Alors ? J’ai ratissé vite fait les feuillets épars. Je les ai tassés pour en faire des liasses et les livrer d’urgence, sans ambages ni fioritures, avant d’être repris dans le tourbillon de la vie…
Difficile dans ces conditions de se faire une opinion de ce patchwork de conjectures. Y a-t-il un parti pris dans ces résumés et dans les extraits ? S’agit-il d’un travail bâclé, vite fagoté ? Ou l’avertissement au lecteur n’est–il qu’une figure de rhétorique ? Je vous laisse à vos tergiversations !
André Rossfelder propose en 1976 un récit historique intitulé « Clipperton l’île tragique ». C’est un roman très documenté qui remonte aux sources de la colonisation mexicaine, à la concurrence entre les sociétés d’exploitation des gisement de phosphate, au réveil du nationalisme mexicain puis au tourbillon révolutionnaire, à l’occupation militaire de l’île, à la tragédie de l’isolement et à son dénouement en intercalant des saynètes, des interviews, des courriers…pour rendre l’histoire probable sinon probante.
1909, pour des raisons économiques et politiques, le Mexique dispute à la France sa souveraineté sur l’île de Clipperton, un malheureux atoll à quelques 1200, 1280, 1500 km de leurs côtes. Ce sursaut d’orgueil patriotique a été attisé par John T Arundel et Lord Stanmore à la tête de la Pacific Islands Company spécialisée dans l’extraction et la commercialisation de phosphate. Or Clipperton possède des gisements de guano, la fiente des oiseaux qui y nidifient depuis … toujours. L’île est déjà exploitée par les américains en toute illégalité et nos compères entendent bien obtenir l’exclusivité de l’extraction.
Les tractations sont laborieuses et lorsque le Général Porfirio Diaz, piqué au vif par les revendications françaises, décide enfin d’armer une expédition pour installer une garnison dans ce no man’s land, les gisements n’intéressent déjà plus la Compagnie qui a découvert l’Eldorado à Océan Islands dans le Pacifique dont les réserves semblent inépuisables et surtout plus facile d’accès. Clipperton n’est désormais plus une priorité mais le Mexique entend bien défendre sa souveraineté devant l’arbitrage du roi d’Italie en arguant de son occupation et de la valorisation du territoire.
C’est ainsi que Ramon Arnaud débarque sur l’île en 1907 à la tête d’une garnison d’une poignée d’hommes et de quelques ouvriers. Femmes et enfants les rejoindront bientôt. Le capitaine Arnaud a un passé trouble. Fils d’émigrés français, plus ou moins ruinés à la mort de son père, il n’est pas très déterminé dans ses choix et s’engage dans l’armée pour le prestige de l’uniforme plus que par vocation. Il aime les mondanités et s’adapte mal à la vie militaire. D’ailleurs, il déserte peu de temps après. Dégradé, emprisonné, il ravale son orgueil et se fabrique une carapace en forme de conscience patriotique et une rigueur volontariste qui lui permet de reprendre vite du galon. Clipperton n’est pas véritablement une promotion comme tente de le convaincre le Colonel Abelardo Avalos qui fait miroiter l’enjeu patriotique et le défi de coloniser l’île avec le titre de gouverneur.
Les premiers temps sont enthousiasmants. La garnison vit au rythme de la levée des couleurs, des exercices militaires… Tout est à faire : construire un village, des installations agricoles, des hangars…. Les navettes avec le continent permettent d’acheminer du fret : les matériaux, les ustensiles, la subsistance et d’embarquer la production de phosphate.
Mais le Mexique connait un climat insurrectionnel. Les principaux leaders comme Emiliano Zapata et Pancho Villa sont restés célèbres. Ramon Arnaud en prend la température au cours d’un bref séjour sur le continent mais il estime que l’île est un refuge le temps que les débordements révolutionnaires se calment. Malheureusement se sont ces bouleversements politiques qui précipitent la garnison dans l’oubli. Elle n’est bientôt plus ravitaillée.
Sur Clipperton c’est l’expectative. On a beau scruter l’horizon, la navette ne vient plus. Le capitaine Arnaud encourage ses soldats mais il doit se rendre à l’évidence, il faut rationner les vivres. Là-dessus un terrible cyclone dévaste l’île et occasionne le naufrage du Nokomis. Les rescapés sont un poids supplémentaire pour la petite colonie. Mais les courageux marins renflouent une chaloupe et partent en mer pour rejoindre Acapulco.
A leur retour à bord de l’USS Cleveland, ils dépeignent une situations politique dramatique et semblent très pessimistes sur de probables secours. Peine perdue, Ramon Arnaud, pétri d’un patriotisme bien chevillé au corps et sûrement échaudé par sa désertion de jeunesse, décide de poursuivre l’occupation de l’île. Seul Schultz, un ingénieur allemand qui n’a plus tout à fait sa raison est évacué. La plupart des résidents viennent de perdre une bonne occasion de sauver leur vie.
Leur régime alimentaire carencé déclenche une épidémie de scorbut. La maladie est épouvantable : saignement, putréfaction, douleurs… Elle n’est pas tout de suite diagnostiquée. Et le malheureux cocotier ayant survécu au cyclone ne produit pas assez de fruits pour enrayer la maladie. Les morts se succèdent jusqu’à atteindre un équilibre précaire pour subvenir à une alimentation équilibrée. Mais les carences sont telles que le dernier enfant d’Elisa Ramon sera victime de retards de croissance et mourra précocement malgré les soins apportés après leur sauvetage.
L’attente est obsédante, angoissante. Ramon est rongé par la culpabilité. Il passe son temps à scruter l’horizon du haut du phare. Victime d’une hallucination, à moins qu’il ait réellement aperçu la silhouette d’un navire croisant au large, il se lance en mer à la poursuite de cette chimère. De la grève les femmes et les enfants distinguent une scène de bagarre. Ramon brandit un pistolet. Sûrement veut-il poursuivre sa course. Dans l’échauffourée, la chaloupe se retourne et les soldats sont dévorés par les requins.
Un homme a échappé à l’hécatombe, Victoriano Alvarez, un nègre baraqué, fainéant, arrogant, indiscipliné, mis à l’écart et affecté au phare pour éviter les conflits. Il s’est bien gardé de rejoindre l’équipage. Il descend au village en fanfaronnant. Il dévoile sa véritable personnalité et se proclame Roi de Clipperton. Il s’empare des armes et exige des femmes d’être traité avec prévenance et dévouement. Elles se soumettent tour à tour à ses menaces, à ses lubies sexuelles et à ses violences. Seule Alicia Arnaud, son icône, semble encore en mesure de lui résister.
C’est la menace d’être toutes exécutées à l’approche d’un navire qui pousse ces femmes à passer à l’acte. Le 18 juillet 1917, le Yorktown, un navire américain venu vérifier que l’île de Clipperton n’abrite pas une base de sous-marins allemands pointe à l’horizon. Alicia Arnaud et Tirzah Randon décident alors d’en finir avec leur tortionnaire. Alicia fait mine de lui céder tandis que Tirzah lui fracasse le crâne à coups de marteau. Recueillies par les matelots, elles témoignent timidement mais sans aucune culpabilité du meurtre d’Alvarez.

Les Oubliés de Clipperton – Claude Labarraque Reyssac
On ne trouve quasiment rien sur l’auteur dans les pages publiées sur internet. Quelques lignes en 4ème de couverture laisse présumer qu’une robinsonnade peut en cacher une autre :
« Rappelons que Mme Claude Labarraque Reyssac est l’auteur de nombreux récits de théâtre qui ont été diffusés en France et à l’étranger et d’un petit roman intitulé « L’île perdue » qui avait déjà pour cadre une terre inhabitée du Pacifique. »
On ne peut présumer de rien sans avoir d’abord dégoté un exemplaire – et la chasse peut être âpre – ni lu le roman mais j’ai souvent constaté que des auteurs y revenaient à deux fois ou plus lorsqu’ils avaient goûté aux robinsonnades…
D’emblée, l’auteur laisse planer un doute sur l’argument de la promotion militaire. Certes il y a bien un enjeu politique et le titre de gouverneur atteste bien de la légitimité de l’occupation mexicaine mais c’est un enterrement de première classe, un exil. Sans y faire clairement référence on perçoit quelque chose qui nous renvoie au Désert des Tartares de Dino Buzzati.
L’ennui s’installe très vite sur l’île. Le temps est rythmé par un régime climatique qui fait alterner chaleur, pluies, tornades, vent…avec de longues période d’inactivité et de claustration dans les habitations et par l’attente du navire de ravitaillement dont l’escouade est tributaire : rotations des hommes, nourriture, outillage, informations…Le temps semble suspendre son vol écrivait un poète ! Et on a l’impression que les personnages ne font plus que compter les jours.
Dans de telles conditions de vie, sur cet îlot stérile et inhospitalier, réserve de crabes et d’oiseaux de mer, soldats et ouvriers ont le mal du pays :
« Oui, nos hommes connaissent tous les « corridos » en vogue lorsqu’ils quittèrent le Mexique, mais tous sont encore capables « d’inventer » de nouveaux chants plaintifs, monotones, émouvants. Ce soir, ils ont « brodé » autour du thème de l’exil, puis ils ont chanté la variété du paysage mexicain. Pablo était le « meneur de jeu ». Il évoqua d’abord les vastes plaines de maïs ; Pancho continua par un couplet sur les collines de caroubiers. Irra célébra les haies de nopal ou de cierges verts, Luis les montagnes boisées aux ravins inattendus ; Andrès, « les blanches fleurs vénéneuses des arbres de Noël » ; Nava, les garrigues aux broussailles revêches ; Thomas, les volcans couverts de neige qui surveillent Puebla. Entre chaque couplet, Pablo reprenait le refrain que je traduis ainsi :
A quand les grandes chevauchées sur les routes du Mexique ?
Quand reverrons-nous des arbres ?
Quand respirerons-nous le parfum du pays ? »
L’attente, le dénuement, l’impuissance ont aussi pour effet de dégrader les relations au sein de la troupe. Les discussions s’enveniment, dégénèrent. Les hommes et les femmes s’invectivent, s’injurient, en viennent aux mains. Ramon de Arnaud doit faire preuve d’autorité et occuper ses hommes. Les projets d’équipement ne manquent pas pour donner de l’allure à la colonie et l’organisation militaire maintient une discipline exemplaire : levée des couleurs, exercices, maniement des armes... Mais cela n’a qu’un temps. L’apparition du scorbut, de la fatigue, des douleurs remet en cause cette discipline. Reste le sommeil qui est comme une petite mort :
« Dormir ou faire semblant. Dormir ou rêvasser. Dormir ou s’abandonner à un état de prostration suscité non seulement par la monotonie de la nourriture mais par le désespoir. »
Autre alternative pour lutter contre l’ennui et l’oisiveté, soutenir la vie sociale et culturelle en proposant des animations régulières : scolarité des enfants, lectures, jeux de cartes, fêtes, théâtre, danse, chansons….Pour l’occasion, Claude Labarraque Reyssac n’hésite pas à créer de toute pièce le personnage de Madeleine de Lurdes, une soi disant cousine de Ramon de Arnaud. Elle n’est pas dupe de son hyper activité :
« Mais, depuis trois mois, la tapisserie, les livres, les pierres ou les insectes ne sont que des alibis, des attitudes qui nous permettent de tenir secret le désarroi de nos âmes. »
Le navire de ravitaillement ne s’est plus présenté aux dates prévues et bien évidemment sans explication. Personne n’est au courrant des lointains remuements de la Révolution mexicaine. Suite au naufrage du Nokomis, la garnison recueille des marins danois qui vivent un temps aux crochets des maigres stocks de la colonie. Après leur sauvetage par l’USS Cleveland, les commentaires vont bon train pour incriminer Ramon de Arnaud qui a refusé de quitter son île et son commandement. L’apparition du scorbut, difficile à identifier d’abord - c’est une maladie qui touche les marins et certaines rares populations atteintes de malnutrition chroniques – marque une rupture sidérante dans le récit. La mort plane désormais sur la colonie. Hommes, femmes, nourrissons meurent dans d’affreuses souffrances, jusqu’à ce que la colonie atteigne le juste équilibre entre ses ressources – quelques trop rares noix de coco - et ses besoins :
« Le scorbut s’arrêtera lorsque la part des survivants sera devenue suffisante pour apporter à l’organisme ce qui lui manque. Il s’agit d’arriver à cet équilibre. Mais à combien de morts encore les rescapés devront-ils leur survie ? »
Dès lors, après la mortalité, l’auteur développe son récit autour des naissances et des angoisses liées à l’arrivée des nourrissons. Les mères sont déjà victimes de malnutritions, l’allaitement pour certaines semble très aléatoire. Les bébés survivront-ils ou subiront-ils des séquelles ? Angel surtout, le fils d’Alicia n’est pas bien portant. Il est maigrelet, vite rassasié, s’endort sur le sein de sa mère, perd ses quelques cheveux…« Longtemps Angel eut l’air de bouder la vie. ». Sa croissance est problématique. A un an il est toujours très faible. Les femmes imaginent lui redonner vigueur avec une cure à base de bains de mer.
La gaîté a définitivement disparu. On spécule sur le défaut de commandement, la culpabilité des uns et des autres. Les obsessions et les hallucinations submergent tout un chacun. A telle enseigne qu’à force de scruter l’horizon Ramon de Arnaud voit-il - ou est-ce un mirage ? - un navire qui croise au large. Avec ses hommes il jette une chaloupe à la mer pour tenter de l’intercepter. Passée la barre, les hommes semblent se disputer. Au cours de l’échauffourée la barcasse chavire et tous les hommes se noient et sont dévorés par les requins. Plus tard ce sont d’autres troubles qui font surface à commencer par le souvenir. Alicia notamment porte son gouverneur de mari sur un piédestal. Son souvenir est bien vivant, cramponné à sa mémoire.
Le dernier volet de l’aventure, c’est l’ascension de Miguel Alvarez. Il se révèle dans toute sa noirceur. On le savait fourbe, cruel, moqueur, associable. On découvre l’étendue de sa mégalomanie. Il se pare des oripeaux ridicules de l’autorité militaire, descend au village et claironne sa souveraineté sur son peuple de femmes. Il instaure son droit de cuissage et de servitude. Les femmes doivent le nourrir, contribuer à son confort comme un pacha. Et si elles ne se prêtent pas à ses fantaisies, il ne s’interdit pas de toucher aux enfants ! C’est une lourde menace qu’il laisse ainsi planer sur ces mamans ! Il installe ainsi définitivement un climat de peur et de méfiance, sans parler de ses visites nocturnes dans les chambres des femmes, le souffle de sa respiration et autres tortures psychologiques.
Alicia de Arnaud lui fait face. Elle dépasse ses appréhensions, s’empare de son rôle de femme du Gouverneur et use de ruses pour le tenir à distance. Telle une pasionaria drapée dans son bon droit, elle tente de protéger la petite communauté. Elle fait illusion mais c’est un rempart bien fragile ! Rien n’y fait. Il descend régulièrement de son phare pour exiger son dû. Les survivantes sont interloquées par son attitude et la violence physique et morale qu’il exerce sur leur communauté. Et s’interrogent sur ses motivations :
« Le caractère, la conduite d’Alvarez étaient souvent le sujet de mes réflexions. Notre sort eût-il été le même si un autre homme que lui avait survécu ? Si Ramon ou Randon avaient échappé à la barque maudite, la question ne se posait même pas. Il avait sa femme légitime et il aurait laissé les autres tranquilles. Mais si un des deux soldats était revenu ? Pablo ? Ou Paco ? Comment se serait-il comporté ? Non ! Aucun des deux n’aurait eu l’idée de se targuer du titre de roi, de s’affubler d’une veste galonnée, de nous humilier. Il n’aurait pas eu cette malice de s’emparer des armes. La santé revenue, l’instinct sexuel, certes, lui aurait fait bientôt désirer une compagne et sans doute aurait-il choisi entre Altagracia et Angéla. Peut-être les aurait-il prises toutes les deux. Mais pas sans leur consentement. Et je ne crois pas qu’il se serait attaqué à Rosalia…du moins pas encore. Et pas sans qu’elle le veuille. Aucun d’eux non plus n’aurait été capable de tuer de sang froid.
Mais Alvarez était Alvarez. La mauvaise tête du petit contingent ! Avait-il été particulièrement humilié dans sa jeunesse ? Etait-ce sa couleur noire qui lui avait valu des quolibets de la part des Mexicains à peau clair ? Avait-il rêvé de vengeance, de puissance ? Quoi qu’il en soit, il avait su saisir l’occasion ! Car enfin, si on ne pouvait le tenir pour responsable de la mort de Ramon et de ses hommes, il n’avait rien fait pour les aider, rien pour participer à l’expédition. Il s’était caché quand Ramon l’avait appelé. Tous, nous avions entendu ses appels, malgré le ressac, malgré le vent. Et si Ramon avait dû laisser quelqu’un pour nous protéger, ce n’est pas Alvarez qu’il aurait choisi.
Oui ! Tout s’était passé comme si le Noir avait su d’avance que l’expédition vers le voilier aperçu était voué à l’échec, que personne n’en reviendrait et que son heure de revanche allait enfin sonner. Il s’était caché ! Il était entré dans la maison de son chef, avait volé des armes. Ah ! Comme il avait dû se sentir fort lorsqu’il avait vidé ce placard, empli ses poches, , garni sa ceinture et jeté le reste à la mer. Oui, comme il avait dû se sentir fort, heureux ! Je le voyais ricaner en imaginant la scène où il nous humilierait. Je l’entendais nous dire : « Je suis le roi de Clipperton. Vous êtes mes épouses. Toutes vous devez me servir à tour de rôle. » »
Voilà bien quelque chose de prémédité. Refoulement, attente patiente, opportunisme, la mutinerie est comme un passage à l’acte. On retrouve là beaucoup de ressemblances avec ce qui s’était tramé sur le Batavia.
Altagrace, sa première concubine est consentante. C’est une façon de snober Alicia dont elle était la domestique et d’inverser les rôles. Désormais, c’est elle la femme du chef. La suivante, Rosalia se voit voler sa virginité et son adolescence. L’enfant qu’elle portera mourra en couche après une bonne volée. Tirza se sacrifie afin d’échafauder une stratégie pour se débarrasser du monstre. Il faut endormir sa confiance, simuler le plaisir et la joie, le berner avant de l’assassiner. Facile à dire – c’est l’instinct de survie qui commande – mais comment la morale peut elle s’accommoder du meurtre ? C’est un vrai cas de conscience qui se pose à elles. Comment qualifier leur complot, leur vengeance, est-ce bien de la justice ?
« - Dieu jugera, dit Alicia ; les hommes aussi si nous quittons cette île un jour. Le meurtre n’est permis qu’en état de légitime défense.
- Comment ! reprit Tirza avec véhémence, il pourrait tuer, violer, torturer et on ne serait pas en état de légitime défense ? Après tous ces crimes, il ne mériterait pas la mort ? Quand je pense que nous n’avons rien pu faire pour protéger Angéla et Rosalia, j’en ai honte. Je me dis que trois ou quatre femmes résolues auraient dû en venir à bout, d’une manière ou d’une autre ! »
Elles prennent aussi conscience que c’est lui ou elles ! Il ne les laissera jamais le dénoncer aux autorités pour être jugé et condamné. Tirza joue son rôle à merveille et crée la situation idéale pour l’exécuter.
« Ah ! Mes sœurs ! Qu’avons-nous fait ? dit Alicia.
Nous avons fait justice, madame, dit Tirza en reprenant ses affaires et son rouleau de pesos. J’ai pris son argent aussi ; il a peut-être de la famille. Traînons-le dans la cabane. Il ne faudrait pas que les enfants le voient. Cet après-midi, nous reviendrons l’enterrer. »
Aussi étonnant que cela paraisse c’est ce jour là qu’un navire de la flotte américaine aborde Clipperton à la recherche d’une base de sous-marins allemands. Et dire qu’on croit que ça n’arrive qu’en littérature ce genre de coïncidence…

L’homme de Clipperton - Gil Pastor
L’auteur prend quelques libertés avec le récit original si l’on peut dire. Il rebaptise les personnages et réinvente l’île. Mais ça reste une adaptation du récit, pas une réinterprétation. Le cheminement est tout à fait identique, conforme à ce que l’on connaît déjà. Peut être tente-t-il de forcer un peu le trait pour décrire Olbius. Encore son imagination est-elle en cale sèche, il y a suffisamment de sous entendus dans les récits des survivantes pour tailler un portrait plus noir encore que quelques scènes de violence littérairement correctes.
Dès le début il plante un décor surprenant. Certes une île dominée par la blancheur du guano qui s’est sédimenté. Mais aussi à l’ouest, une forêt, une palmeraie et au nord une lande tapissée de fougères et dominée par un cèdre. Très vite les hommes s’installent, créent une ferme, un corral, des hangars. Et comme dans une véritable robinsonnade – il devient évident qu’il y a une familiarité avec les travaux de colonisation – ils se lancent dans un grand travail de défrichement et de culture du maïs, des pommes de terre et des fèves. Les tornades ont tôt fait de ruiner leurs efforts. Par sécurité, ils préservent au mieux leurs réserves au risque de développer un régime carencé. Et lorsque ce ne sont pas les éléments climatiques qui perturbent la vie quotidienne, ce sont les lapins – tels les 7 plaies d’Egypte – qui prolifèrent dangereusement, minent l’île de leurs terriers et avalent toute la verdure. Le bétail qui a survécu dépérit. Malgré les battus hystériques ils n’en viennent pas à bout. Seule façon de sauvegarder un peu de verdure : la culture en jardinière !
Le couple Arbel – Elvira est présenté comme timoré sexuellement, voir refoulé pour ce qui concerne le commandant qui lorgne sur Magdalen une jeune servante qu’il désire secrètement et crée chez lui une contrariété absolue pour tout ce qui touche à la liberté de la jeune femme à qui il interdit toute relation avec d’autres hommes et en l’occurrence avec son second qui se voit refuser l’autorisation de mariage. Devant ce refus têtu les passions son exacerbé au point de remettre en cause l’autorité de la hiérarchie et ce n’est au terme d’un scandale qui éclabousse toute la colonie qu’il admet ce mariage du bout des lèvres.
Le scénario fleure bon l’injustice. Olbius, le nègre, pose lui aussi des soucis difficiles à solutionner. C’est un caractériel et un associable. Tout devient l’occasion de chamailleries et plutôt que de faire preuve d’autorité, il adopte des solutions qui ne satisfont personnes et surtout donne l’impression qu’il soutient le gens foutre contre les gens honnêtes. Cet univers confiné devient le théâtre d’intrigues où des scènes d’abattement succèdent à des scènes de frénésie. Les rôles y sont souvent redistribués. Malen, le second, a plus de qualités relationnelles. C’est une courroie de commandement efficace. Il est apprécié des hommes. Au final, il se sent seul et incompris, peut être dépassé par une mission de colonisation qu’il a surévaluée. Il a tendance tout de même à penser qu’il vaut mieux avoir raison contre tous au risque d’être mal aimé.
« Un curieux phénomène de dépersonnalisation apparut également.
Ils se mirent à pérorer comme des acteurs et, abandonnant toute identité, se donnaient en spectacle. Ils se dépouillaient de tout caractère propre pour adopter un rôle de composition qu’ils menaient avec une conviction de cabotin. Toute une foule de héros déclassés affronta alors les feux de la rampe sur un théâtre de sable. On en vit certains devenir des matamores ou travestis, évêques et don juans. Les rôles pouvaient changer d’un instant à l’autre et l’on put surprendre dans l’arène le roi Philippe pleurer pour un cheval ou Jeanne d’Arc se mettre à ondoyer comme une putain.
Ils ne cessèrent plus de jouer entre eux de petites comédies parfois languissantes et presque toujours cruelles et ne les dénouaient que pour en entamer une autre. Le moindre prétexte était bon pour faire partir une intrigue à laquelle tout le monde se collait en s’échinant à attraper le beau rôle. Il y avait des coteries qui se formaient et se disloquaient, des affrontements interposés et des amours feintes ou sincères. On maria ainsi deux des plus grands enfants sans que personne ne pût dire après le jeu de la noce si on les avait vraiment unis ou si tout cela n’avait été que fantaisie. »
L’île est un monde irréel, statique, monotone, ennuyeux qui exacerbe les sentiments d’abandon et crée un vague climat de dépression. Seuls les objets de pacotille laissé par le navire de ravitaillement rappellent encore le continent, le passé, la vie, la vraie ! En l’absence de nouvelles, tout le monde psychote un peu. Ils divaguent complètement et imaginent que la guerre fait rage avec l’Angleterre. C’est le branle bas de combat. Ils décident de construire un réseau de fortification, de s’entraîner âprement au combat en corps à corps. Même les femmes sont enrôlées.
Olbius rechigne à cette mascarade et il est banni sur les rochers noirs. Il s’accoquine et s’accouple avec Doña, la guérisseuse du village. Surpris dans leurs ébats la guérisseuse met son talent au profit de la fabrication de poisons. Le premier à disparaître c’est Malen. Magdalen est sauvée in-extremis. Cette mort passe plus ou moins inaperçue au milieu de la vague de mortalité due au scorbut. Doña Don mi prêtresse mi sorcière instaure une situation de paganisme chrétien et tente d’endiguer la maladie à grand renfort de prières, d’incantations, de sacrifices, de flagellations…Elle crée un climat mystique et magique et dans ces conditions les hallucinations d’Arbel témoignent du bouleversement psychologique, de la montée de la folie chez certains des protagonistes, trop longtemps coupés du monde, trop longtemps dans l’oubli…C’est dans ces conditions qu’apparaît le steamer et que les hommes disparaissent en mer en voulant maladroitement l’aborder.
Le dernier quart du livre se concentre sur le martyr – le terme est un peu fort – des rescapées et de leurs enfants. D’abord elles se croient les seules survivantes mais Olbius fait son apparition. Il fait croire qu’il a échappé à la noyade mais Magdalen n’est pas dupe et le lui signifie clairement ce qui a le don de le faire sortir de ses gonds. Quant à Doña Don, elle peut enfin afficher son attirance. Les relations entre les rescapés sont particulièrement ambiguës. D’abord Olbius reste très proche des enfants. Ils vivent de l’air du temps, jouent au milieu des ruines des fortifications…Les citronniers et les orangers plantés au début de l’aventure produisent enfin des fruits ; les légumes semés en jardinières viennent à maturité.
Ce n’est que plusieurs mois après la tragédie qu’il commence à dysfonctionner. Il devient narcissique, exerce son droit régalien sur l’île et son droit de cuissage sur les femmes. Doña Don joue à ses côtés le rôle d’éminence grise et excite sa mégalomanie. Ensemble ils pillent les costumes du gouverneur et brûlent la commanderie. Il s’intronise maître de l’île au terme d’une cuite mémorable. Il a dès lors basculé définitivement dans la folie. Il devient taciturne, colérique, violent, féroce sauf envers Magdalena. Il caresse le projet de l’édification d’un mausolée. Il met au travail femmes et enfants, flagelle les récalcitrants et les traînards, il mutile même un gamin qui a osé uriner sur son monument.
« Une bile acide l’envahit. Il se tendit, bondit et renversa le môme. Tous deux perdirent l’équilibre et roulèrent jusqu’en bas des degrés [du mausolée]. Armando, à moitié assommé, empêtré dans ses habits, se releva à grand-peine. Il recevait des volées de coups ; le nègre tapait sans trêve et ses poings moulinaient devant lui un corps flasque qui ne cherchait même pas à se défendre. Armando retomba. Le nègre continua à le frapper du pied. Dans la lueur de la lune, il vit les chairs nues et claires du gamin. Une folie le prit. Il lui attrapa les parties dans ses mains énormes et se mit à les serrer de toute sa poigne. Le gamin hurlait. Le gamin hurlait. Olbius serra encore plus fort. Il sentit ses ongles arracher une mollesse palpitante. La nuit porta la douleur d’un cri immense. Le nègre assourdi relâcha sa prise. Il avait définitivement mutilé Armando Diaz. »
La peur s’installe. Tout le monde s’enferme sous son appentis pour échapper à sa démence. Pour mettre fin à cette situation délirante, Magdalena se sacrifie et se rapproche de lui à condition qu’il cesse ses violences. Les survivants – et en premier lieu Armando Diaz – le molestent lorsqu’ils voient apparaître un vaisseau de secours.
Quelques lignes sur l’après : Magdalena – profondément traumatisée – traîne sa pauvre existence de port en port, d’homme en homme avec Armando Diaz accroché à ses basques.

Le Roi de Clipperton – Jean-Hugues Lime
Prétexte du récit : 1921, Quai d’Orsay, des fonctionnaires tentent de remettre la main sur le dossier égaré pendant les affres de la grande guerre du litige qui oppose la France au Mexique et mis en jugement entre les mains du roi d’Italie.
Le flash back commence avec l’arrivée de la garnison sur l’ilot de Clipperton. Rapidement l’installation met en évidence l’incompétence ou plutôt l’imprévoyance du gouverneur Ramon Arnaud car rien de ce qui sort des soutes du navire ne correspond aux besoins réels d’une telle expédition. C’est aussi un piètre meneur d’homme qui manque cruellement de charisme. Il sait pertinemment que sa promotion n’est qu’un leurre. C’est un exil sans gloire. L’auteur ne manque d’ailleurs pas une occasion de faire un parallèle avec le Désert des Tartares qu’il cite en référence de sa bibliographie. On verra d’ailleurs que son roman est construit comme un feuilleté de références à l’univers des robinsonnades.
Son portrait est en effet assez peu flatteur : « Se laissant vivre au fil des années, il avait atteint la trentaine sans bien s’en rendre compte. Il avait perdu aussi sa jeunesse que ses cheveux. Son visage était empâté. Il avait grossi de quinze kilos à force d’attente dans les casernes. Déjà un peu bouffi, il avait parfois des accès de goutte et boitait du pied gauche. Le héro n’était qu’un fils de marchand de bottes. Le conquérant n’était qu’un petit gros, pataud, incompétent, maladroit et balourd dans ses moindres gestes. Son accoutrement de ganache endimanchée dans cet univers sauvage le rendait ridicule. Avec ses bourrelets, il lui semblait n’être qu’une marionnette qui promenait ses dorures, exhibait ses couleurs de perroquet, montrait ses chamarrures aux oiseaux. Arnaud toussait aussi beaucoup, gêné par l’embrun, les vents humides du large. Exposé au soleil, aux assauts de l’air marin, sa peau se recouvrait d’une invisible croûte de sel qui la rendait craquante et sensible. Lorsqu’il passa la langue sur ses lèvres, il sentit aussitôt le goût du sel dans sa gorge comme lorsqu’on boit la tasse. Il était aussi affligé d’une odeur forte des soldats, leur haleine de tequila, leurs gros mots, les injures qu’il entendait proférer sans cesse, leur débraillé. Les continuels rappels à l’ordre qu’il était obligé de crier le fatiguaient. »
Plus loin, l’auteur complète le portrait à l’occasion d’un flash back : « Il se revoyait dans sa famille, adolescent, élève maigre et médiocre. Combien ses parents avaient été fiers de le découvrir en grand uniforme d’officier de l’armée fédérale ! Ils l’avaient pistonné auprès de l’état-major pour qu’il entre à l’école des cadets. Au contact de ses camarades, il s’était révélé un élève officier sans qualités réelles. Ses notes étaient nulles malgré le temps qu’il passait à bûcher les manuels militaires, comprendre les lois de la balistique. Son intelligence ne parvenait pas à s’ouvrir aux subtilités du Code militaire. Ce qui ne l’empêchait pas de rêver de conquêtes et de victoires, de charges de cavalerie dans les grandes plaines. Son imagination, qui peinait à se concentrer sur des problèmes de maths, s’échappait vers d’autres contrées plus heureuses. Il n’avait pas, loin s’en faut, le talent de son ambition. Il ne savait que rêver et cela ne lui rapportait rien. La rêverie est un talent inutile chez un militaire efficace. Arnaud était un doux rêveur limité jusque dans ses rêveries. Il ne savait que ruminer des projets sans suite, incapable de leur donner corps. Combien de fois, lassé de ses difficultés insurmontables, il avait galopé bride abattue à travers la pampa, se prenant pour un intrépide lancier de Napoléon. »
C’est l’occasion, aussi de brosser un rapide portrait de l’autre personnage important de l’histoire : Alvarez affublé de tous les défauts du monde. Il est faignant, taciturne, insolent, rebelle au commandement, indiscipliné. C’est pourtant lui dans un acte héroïque qui passe les dangereux récifs à bord d’une barcasse déséquilibrée, secouée par le chargement d’un piano, en se jetant à l’eau, harnaché pour tirer à la nage l’embarcation, au risque d’être dévoré par les requins. Son courage et son insolente réussite son mise sur le compte de son inconscience et de la rustre.
L’installation de la garnison et des ouvriers carriers donne lieu à un grand élan de construction : hacienda, tienda, armurerie, infirmerie, bodega, magasin et tous les autres bâtiments d’exploitation du phosphate. Le travail dans les carrières de guano est pénible. Toujours sous les agacements des oiseaux qui voltigent au dessus de la tête des hommes. Schutze, l’ingénieur allemand, laissé à demeure est assez narquois. Il a pris la mesure de l’île et semble très réticent face à cette hyperactivité dérisoire.
Premier camouflet de l’île l’échec du jardinage. Le sol est stérile et les frêles pousses sont vite dévorées par les crabes. La culture en jardinière ne fonctionne pas mieux et lorsqu’enfin les premiers légumes rabougris apparaissent, ils sont emportés par les pluies diluviennes. Le peu qui est sauvé sera définitivement pillé par les oiseaux qui profitent de la sieste des sentinelles pour tout piller.
Ensuite, c’est la lente détérioration des équipements. Le ponton d’abord qui devait permettre au bateau de charger les sacs de guano sans danger s’effondre avec les ouvriers en train de travailler, noyés et dévorés par les requins. Plus tard, lorsque le Ramon Arnaud et les derniers hommes de la garnison disparaissent en mer, une tempête dévaste le village qu’il faudra consolider de bric et de broc faute de matériaux. La colonisation est une lente décrépitude. Vanité, tout n’est que vanité. L’ingénieur Schutz l’avait prophétisé en d’adressant à Alicia Arnaud lors de son départ : « Je vais vous faire une confidence, continua l’ingénieur ; je connais les îles, celle-là en particulier. On ne construits pas une civilisation sur les lèvres d’un volcan, sur de la fiente de mouette. Tout ce que votre mari a bâti s’effondrera. »
On est là dans l’éternel opposition nature/culture clairement exprimé en fin d’ouvrage : « La Nature conspirait à exclure les hommes de l’île. Ils étaient soustraits du monde des vivants comme on extermine une espèce nuisible et dangereuse avec lenteur et détermination. La Nature les broyait sans pitié comme les hommes avaient brûlé la Nature partout où ils s’étaient crus supérieurs.
Jusque là, la mort leur avait semblé cruelle mais légitime. A Clipperton, il s’agissait d’une désespérante éradication du genre humain au compte-gouttes. Les hommes avant d’être éliminés étaient déshumanisés. Perdant toute puissance, ils étaient ravalés au rang de vulgaire espèce en voie de disparition. Ils ne valaient guère plus qu’une mouette, qu’un poisson-lune qu’ils s’amusaient jadis à gonfler pour les faire exploser ou qu’un de ces chétifs poussins qu’ils piétinaient de leurs grosses semelles cloutées de soldats, eux, les chrétiens civilisés.
Comment survivre, maudit ainsi par ceux qui vous dominent ? Maintenant qu’ils se savaient perdants, les survivants auraient bien voulu faire la paix avec l’île, négocier avec ses forces secrètes mais il était trop tard. La Nature avait décidé pour eux. Un mystère qui n’était ni Dieu ni le Diable, échappant à toute représentation humaine, les exterminait. »
Les soldats aussi désespèrent. Ils regrettent d’avoir laisser filer le Korrigan dernier navire à faire la liaison avec le Mexique sans prendre place à bord. Les évènements politiques et les idées révolutionnaires qu’il a entendu de la bouche de l’équipage conduisent Alvarez à un peu plus de cynisme et d’insubordination. Il s’éloigne de la troupe, vit à son gré. Le sentiment d’abandon de la hiérarchie militaire, l’attente de la relève et la monotonie démobilisent la garnison et plombe la vie sociale encore rythmée par le protocole de la vie militaire, le levé des couleurs, l’inspection des troupes mais aussi les fêtes et les sacrements. Alors pour remobiliser la garnison Ramon Arnaud imagine de fortifier l’île en cas d’un hypothétique débarquement des ennemis du Mexique. Ils créent ainsi un réseau défensif à la façon d’un Vauban C’est une idée directement empruntée à Gil Pastor qu’il ne cite pas en bibliographie par contre. L’attrait est de courte durée et garnison retombe dans sa déchéance. Ramon Arnaud semble de plus en plus en retrait des contingences de la garnison, garnison décimée par le scorbut. Il se renferme sur lui-même, perd pieds avec la réalité, se décharne littéralement, délègue le commandement et lorsqu’il sort enfin de sa retraite c’est pour embarquer ses hommes vers la mort…
Alvarez fait un parcours bien différent. Son indiscipline lui attire les foudres de Ramon Arnaud qui passe son temps à le punir et l’humilier jusqu’au seuil de rupture, celui où il déserte la garnison pour se réfugier au phare. A partir de là, Alvarez va faire une l’expérience d’une vie naturelle. Jean-Hugues Lime lui fait suivre à quelques choses près le même retournement existentiel que le Robinson de Michel tournier. C’est ainsi qu’on retrouve Alvarez se coule dans une fosse dans la lagune comme Robinson dans sa soue. « Alvarez, afin d’échapper aux grandes chaleurs, s’était fait un trou dans un des coins les plus sales de la lagune et disparaissait tout entier dans cette bauge. Il languissait toute la journée dans son lit de boue à base de feuilles en décomposition qui dégageaient une odeur d’humus, de composte et d’œuf pourri. Couvert d’algues noires, il s’enfouissait à l’abri des regards, entièrement nu, et regardait les femmes se baigner plus loin. » Alvarez semble surmonter les épreuves de la maladie avec plus de facilité. Il ne réapparaît dans le village qu’un mois et demi après la disparition de Ramon Arnaud. Il est dépenaillé, hirsute, attifé de colifichets. Il a l’air d’un sauvage. Dans sa retraite il a fait l’expérience de l’animisme, du chamanisme. Il s’est créé un dieu tutélaire : le Soleil ! C’est un nouvel Alvarez qui rentre sur le campement. Les femmes l’entourent de leur attention, de leur sollicitude jusqu’à ce que leur libido les jettent dans les bras de celui qu’elles exécraient jusqu’à lors.
Altagracia s’entiche d’Alvarez et s’offre à lui. Ils copulent sans discrétion un peu partout sur l’île. Elle devient son éminence grise, réveille son besoin de vengeance pour toutes les humiliations qu’il a subi. Une seule personne échappe à son ressentiment, c’est Alicia dont le désir puissant est refoulé. Cette femme est inaccessible, on le sait depuis le tout début du récit. Du coup il tente de s’imposer comme le mâle dominant, dominateur « je suis l’homme ! » s’exclame-t-il. C’est le début d’un règne ubuesque quelque peu escamoté par l’auteur. Alvarez règne sur les femmes du haut de son piton rocheux, entouré d’oiseaux qui assurent sa sécurité comme les oies du capitole. Le dernier acte se précipite un peu. C’est l’exécution. Le roman se boucle sur un retour au Quai d’Orsay sur le jugement du roi d’Italie qui accorde la propriété de Clipperton à la France.
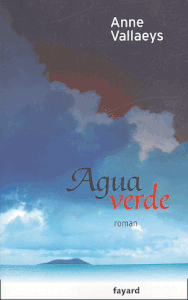
Agua verde – Anne Vallaeys
L’auteur est une aficionada du Mexique. Elle a cosigné une trilogie intitulée Les Barcelonnettes qui retrace le formidable destin de ces colporteurs de Hautes Provence qui ont émigré et connu des fortunes diverses tout au long de cette histoire tumultueuse d’un pays en quête d’identité politique et de stabilité. Agua Verde est par contre un roman d’atmosphère – sonore et visuel - et un roman psychologique dont l’écriture plus éthérée tranche avec le récit historique surchargé.
Passés les récifs, le lieutenant Tomas Rousseau débarque sur Agua Verde entouré de sa garnison et d’ouvriers italiens recrutés à San Francisco par la Compagnie Berlinoise pour extraire les gisements de phosphate. C’est la mondialisation avant l’heure ! Il découvre l’île au milieu du bruit des bourrasques de vent. A première vue c’est une terre hostile. Il la scute, la sonde pour imaginer où et comment fonder son établissement. Voici son portrait :
« Tomas Rousseau était l’un des meilleurs officiers. […] Raffiné, visiblement élevé dans le meilleur milieu, il manifestait une indifférence hautaine, une soumission orgueilleuse […]. Rousseau parlait peu avec ses pairs, et durant ses heures de repos, il préférait rester seul, à étudier la musique. Un coffret de guitare accompagnait son paquetage, et il se disait qu’il était virtuose. Au fond, on connaissait bien peu de chose de son caractère. »…/… « Partir, sortir du monde, il vivait de cet espoir. Persuadé qu’un destin l’attendait, il s’était réfugié dans la rêverie, dans un indéfinissable dilettantisme. Administration, commerce, il avait tâté de toutes les professions, mais l’idée de s’engager dans les affaires le heurtait. Seules, la littérature et la musique trouvaient grâce à ses yeux ; il s’y adonna donc, mais cette passion immature le quitta bientôt. Il abandonna l’étude des beaux-arts et insensiblement se laissa emporter par l’oisiveté et ses voluptés. L’imagination devint son havre. Son père ne lui pardonna pas cette faiblesse. La chance n’était-elle pas avant tout ce que les hommes en font ? Lui, n’avait rien laissé passer quand, ruiné par la maladie qui s’en était pris à ses vignes, il était parti pour l’Eldorado en compagnie de son épouse, en 1874. Si, grâce à son entreprise de tramways urbains, il avait réussi à se hisser au sommet de la bourgeoisie d’Orizaba, il n’avait rien oublié du prix payé pour y parvenir. On comprend qu’un tel homme eût pu éprouver quelques déceptions devant l’inconséquence de son rejeton. Et fils unique,, encore ! »
Tomas Rousseau et Arthur Straub – l’ingénieur – décide de séparer leurs cantonnements pour éviter trop de promiscuité. La garnison construit un village solide et austère tandis que les ouvriers s’installent dans un dortoir et une salle commune rudimentaires. L’un et l’autre ont d’abord de grandes ambitions. Le gisement offre de belles perspectives d’exploitation. Rousseau quant à lui entend bien faire œuvre de civilisation. « [Mon labeur] consiste à donner figure à cet atoll, accorder signification humaine à ce désert. Quelle est la plus belle mission de notre espèce, sinon celle-ci ? »
Un seul homme semble déjà se mettre à l’écart. C’est Plutarco Mazocoba, un indien Yaqui, qui s’est attaché corps et âme à Tomas Rousseau.
« Il s’appelait Plutarco Mazocoba, mais personne ne le désignait autrement que par le nom de sa tribu : le Yaqui. Comme si ces deux syllabes, sèches, brèves, révélaient l’antagonisme, le mystère que suscitait c’est l’homme. Mazocoba ne ressemblait à nul autre. Enfants du désert du Nord, issus de générations de rebelles, guerriers naïfs et orgueilleux au point d’avoir pu croire partager la liberté des aigles et des fauves des forêts du Sonora, il avait l’allure scandaleuse des hommes intègres. Une façon de se mouvoir, rapide, effleurant la terre, une habitude innée de bondir sans bruit, une manière de s’accroupir sur les talons et de rester des heures ainsi. De taille plus haute que les autres hommes, le Yaqui était svelte, taillé pour la course. A peine hâlé, presque blanc, le cheveu brun, il avait les dents limées, et trois cicatrices à chaque pommette balafraient ce visage aux yeux sombres.
En marge des palabres, l’indifférent ne se cabrait jamais devant le labeur. A la nuit, il allait s’assoir à l’écart, tourné vers l’inconnu, comme s’il écoutait couler le temps. Il ne semblait plus conscient des présences qui allaient et venaient. Ses compagnons de garnison tentèrent, un temps, de l’entreprendre, mais le silencieux par nature ne répondait que par phrases courtes et saccadées, à contrecœur, pour ainsi dire. Dès lors on prit l’habitude de le laisser en paix. Plus étrange était la façon dont ce taciturne s’était attaché à la personne du lieutenant. Il semblait veiller sur lui, jaloux, ne s’endormait jamais avant lui. Au lever du jour, il surgissait à côté du chef. Servilit2 de l’esclave envers le maître ? Il était impossible, pour qui examinait leurs rapports, de se douter que cet homme-là ne fût dévoué corps et âme au lieutenant, mais l’observateur n’aurait pu en expliquer le mobile. Pas plus qu’il n’aurait pu dire pourquoi Tomas Rousseau avait fait du Yaqui son ordonnance. »
Les premières semaines sont riches de projet : rédaction d’une charte, érection d’un phare, arrivée des femmes…mais bientôt le mauvais arrête les travaux. L’inactivité est propice aux rêvasseries, aux souvenirs, au mal du pays. Plutarco, lui, semble faire corps avec la nature et s’absorbe dans le spectacle des oiseaux et la contemplation du paysage. Il s’isole sur son phare.
Lilia, la jeune femme de Tomas débarque sur l’île, aménage sa demeure de façon bourgeoise. Elle est gaie, sociable, disponible et se propose de faire l’école aux quelques enfants. Tomas Rousseau culpabilise de l’avoir entraîné dans cette aventure. Straub quant à lui est au chômage, la Compagnie abandonne l’exploitation et rappelle les ouvriers. C’est le tournant de l’aventure. La colonisation a atteint son comble, la suite n’est qu’une succession de désillusions à commencer par le fiasco du jardin. Il prend conscience de la vanité de ses prétentions : « [Tomas Rousseau] avait organisé Agua Verde, et son œuvre lui avait donné la conviction de la victoire nécessaire sur la sauvagerie et la désolation. Il s’était laissé éblouir par l’incontestable réussite de son action au point de ne plus soupçonner la vérité profonde de cette île absurde, arraché du néant. Celle-ci lui rappelait sans cesse son incommensurable hostilité. La lutte n’était donc qu’ébauchée, sans cesse il faudrait se battre. Mais qui se souciait là-bas de ces efforts dérisoires ? Ces sombres pensées épuisaient le lieutenant, elles le laissaient vide, proie offerte au doute. »
Tomas Rousseau est nommé gouverneur d’Agua Verde. Il retourne quelques semaines au Mexique pour recevoir son titre. La Révolution est en route. Et lorsqu’il retourne sur l’île, il ressent la pesanteur de leur isolement et le sentiment confus d’être à la fois à l’abri des remuements politiques mais aussi absent, empêché d’agir en bon patriote. Dans ces conditions, l’exercice du commandement devient pénible.
Mazocoba s’enfonce dans un univers magique : « L’indien, il est vrai, s’était détaché de la communauté. Les années passant, il était devenu tout à fait taciturne. S’enfonçant dans sa solitude farouche, il disparaissait des jours entiers, sans qu’on s’inquiétât de lui. Son temps s’écoulait dans l’ombre du Rocher, au pied duquel il s’était construit un abri avec des blocs de coraux liés les uns aux autres par du sable cimenté. Nu-tête, immobile, suspendu sur la margelle de la tour au-dessous du fanal de laiton, il songeait, peut-être. Le reste du temps, accroupi sur les talons, il s’adonnait à des travaux inutiles qui laissaient douter de son intelligence. Il confectionnait des babioles, taillant le bois, nouant des chiffons de couleurs vives, des jouets qu’il distribuait aux enfants quand d’aventure ces curieux venaient troubler sa retraite. C’était d’étranges effigies, des idoles, des épouvantails, des je-ne-sais-quoi, aux traits sculptés et peints. Lilia jugeait effrayants leurs yeux démesurés, leurs canines en éclats de coquillage. »
Puis vient l’oubli. Le ravitaillement fait défaut. L’agacement, l’attente, les privations génèrent du stress, de la colère. L’isolement est pesant. L’impuissance frustrante. La déprime s’installe définitivement avec le rationnement.
Le Lincoln, un navire américain en route pour Acapulco pour embarquer ses ressortissants en danger croise à proximité de l’île et y fait relâche en apercevant des signes de détresse. Les nouvelles qu’il apporte ne sont pas bonnes. C’est peut être pour la garnison une chance de rejoindre le continent mais Tomas Rousseau y répugne.
Cela fait 6 ans déjà que la garnison occupe l’île. Ils sont loin les soldats fringants. Le laisser-aller est de mise. Pour le tableau, un cyclone efface les derniers signes de civilisation. Mais les iliens relèvent le défi de reconstruire le village de bric et de broc en l’absence de matériaux. Chacun met la main à la patte spontanément ce qui coupe définitivement les liens de subordination avec Tomas, définitivement spolié de son commandement. L’absence de secours les enferme dans la misère. Malgré leur faiblesse ils pêchent et chassent les cochons sauvages. La culpabilité de Tomas Rousseau est désormais bien ancrée. Elle vire à l’obsession, à la dépression, aux hallucinations qui conduit à l’accident mortel en chaloupe.
Plutarco Mazocoba réapparaît sur le village quelques jours après le naufrage de ses compagnons d’arme. Il est malade, fiévreux, délirant, possédé peut être. Il joue les protecteur et se rend utile mais retourne au phare en compagnie de Pepa, l’une des survivantes. Mais lorsqu’il essaie de forcer Angelina, Lilia s’interpose et le tance sévèrement. Cela déclenche de la colère et de la rébellion. Après tout il est le dernier mâle de l’île et il entend bien se faire respecter. Dès lors il règne sur le village et condescend à partager sa pêche. Ces compagnes subissent sa maltraitance et la peur des violences développe l’instinct grégaire des survivantes. Plutarco a développé pour Lilia, l’icône, la femme inaccessible, une dévotion qu’il exprime en construisant un sanctuaire où il pense pouvoir la prendre. Mais elle précède l’inéluctable et fomente un guet-apens au cours duquel Plutarco est assassiné.
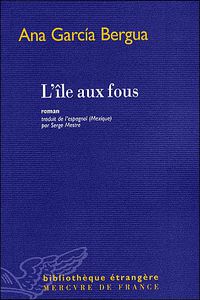
L’île aux fous - Ana García Bergua
Enfin, dernier roman paru, L’île aux fous est particulièrement intéressant parce que son auteur est une « journaliste et critique » mexicaine – donc concerné au premier rang parce qu’il s’agit tout de même d’une histoire nationale. En tout cas, rien à voir avec le roman d’André Soubiran (une robinsonnade ?) qui nous emmène dans l’univers de hôpital psychiatrique.
L’auteur s’amuse à casser la structure linéaire du récit, à le saucissonner et alterner des chapitres sur les origines et le déroulement de la robinsonnade avec des chapitres sur la délivrance des survivantes, le retour et de la combat des femmes pour faire reconnaître officiellement la responsabilité de l’état dans leurs malheurs et toucher les soldes et pension de leurs maris.
Toutefois, pas de surprises, Ana García Bergua suit assez scrupuleusement le récit que l’on connaît bien désormais. Elle rebaptise par contre protagonistes. Pourquoi ? Pour garder des libertés vis-à-vis de la vérité ? C’est vrai que jusque là on ne connaissait rien des modalités du retour sur le continent et de la postérité des personnages. Donnent-t-elle un récit authentique ou n’est-ce qu’une extrapolation ? Qu’importe, tout est permis dans le roman !
L’aventure des survivantes débute au moment où la chaloupe du lieutenant Scott accoste sur Clipperton, la découverte des vestiges du village et du cadavre de Saturnino, le crâne défoncé. Chacune des femmes tente de recouvrer un peu de dignité après la longue et profonde détresse qu’elles ont vécue avec leurs enfants. Elles découvrent un monde secoué par une guerre mondiale. Mais déjà se profile la crainte de la prison. Sur le quai, Monsieur Roca attend le retour de sa fille Luisa (la femme du gouverneur). C’est une réception en grande pompe, couverte par la presse. Rapidement c’est la déconvenue. Les gouvernements se sont succédés et le président Carrenza n’entend pas dédommager les veuves et de leurs enfants. Il ne se sent pas responsable des engagements pris sous les précédents gouvernements. On ne leur propose même pas un emploi dans une administration.
Luisa retrouve ses anciennes connaissances. Elles aussi ont connu des vicissitudes au cours des remuements politiques et de la révolution. Mais nombreuses sont celles à s’être liées avec les nouvelles classes dirigeantes. Certaines sont compatissantes, d’autres se félicitent d’avoir repoussé à l’époque ce « cadet » un peu fou pour avoir accepté d’être affecté sur l’île. Luisa – fidèle à sa mémoire - prend évidemment fait et cause pour son mari. Très longtemps elle se sent comme une naufragée. Ses souvenirs sont restés là-bas. Tout la ramène à ses souvenirs : son destin exceptionnel, son adaptation pour survivre, son retour tonitruant et désormais l’enlisement de ses démarches et le sentiment d’injustice, de s’être sacrifié pour la patrie sans aucun remerciement.
Pour obtenir un peu de reconnaissance Esperanza Onozco témoigne de l’horreur qu’elles ont vécu avec leur Barbe Bleu. La honte qu’elles ressentaient devient sous la plume des journalistes une souillure indélébile. Cette couverture médiatique a pour objectif de forcer la main aux autorités. Mais malgré tout, elles ont du mal à faire reconnaître leurs droits aux pensions de leurs maris. Le lieutenant Scott qui les a délivrée continue de correspondre avec Luisa dont il est tombé amoureux, mais elle rechigne à refaire sa vie avec lui. Elle reste fidèle à la mémoire de Raul Soulier. D’une certaine façon elle est restée scotchée dans une vie idéale sur l’île. C’est ce qu’elle écrivait à son mari avant de le rejoindre :
« Moi, j’ai toujours rêvé de mener une vie romantique, je conçois l’amour comme une grande aventure, loin de l’existence monotone que j’ai menée jusqu’à présent. Et je n’ai pas peur, je ne pense même pas aux privations, mais plutôt aux choses belles que nous pourrons faire là-bas. Imagine que nous sommes un couple de Robinson, ou mieux encore, Adam et Eve régnant sur cet endroit paradisiaque, sous le soleil, à l’ombre des cocotiers, en train d’élever nos enfants, d’éduquer les soldats, les habitants de l’île, de leur inculquer les valeurs du monde idéal dont nous rêvons toi et moi : la musique que tu aimes tant, la poésie, l’histoire du Mexique et du monde. Imagines-tu ce que peut signifier vivre dans un lieu où rien d’autre ne compte que les idéaux, sans autre autorité au-dessus de nous que notre volonté, avec l’aide de tous ces soldats, un monde à la mesure de nos désirs et de nos rêves ? »
Le procès tourne en faveur des survivantes malgré les suspicions et les réflexions machistes. Elles sont acquittées du meurtre de Sturnino et les orphelins placés en institutions. Ils ont du mal à s’adapter, pleurent beaucoup, quant à Juanita, la jeune fille violée par Saturnino, elle reste prostrée et se nourrit à peine.
Le Mexique a changé mais les gamins surtout s’habituent vite à cette nouvelle vie : tramway, cinéma, restaurant, automobiles, magasins... Ceci dit leur vie naturelle, à moitié nue, sans contrainte, en bord de mer, sous le soleil, a laissé des regrets et de mauvaises habitudes. Il faut les rééduquer.
Chaque jour les femmes perçoivent que les carences dont ils ont souffert a laissé des séquelles ne serait-ce que chez le cadet de Luisa qui ne marche toujours pas à 2 ans. Le moral en a pris aussi un coup. Leurs nuits sont peuplées de cauchemars. Le petit Angelito finit par mourir et les autres enfants se demandent si cela sera bientôt leur tour. C’est finalement un mal pour un bien. Luisa est soulagée mais Esperanza, la nurse, culpabilise.
Enfin, changement de politique, Obregón, le nouveau président décide de faire de Raúl Soulier un exemple de patriotisme et du coup concède finalement sa pension de veuve, une petite pension qui lui permet tout juste de s’installer, vivre, scolariser les enfants et les loisirs. La capitale offre des loisirs, on ne peut pas vivre comme des animaux !
Esperanza est recueillie par sa famille. Que faire désormais ? Elle ne sait que s’occuper des autres, nourrice d’Angelito et garde malade de Mr Schubert (l’ingénieur) qui avait sombré dans la folie sur l’île et elle est trop moche pour trouver un mari. Parti en ville chercher un crédit pour ouvrir un petit magasin, elle retrouve justement Schubert qui l’attend depuis des mois. Ils se jettent dans les bras l’un de l’autre.
Fatiguée, malade, Luisa s’inquiète jusqu’à sa dernière heure pour ses enfants qu’elle laisse sans fortune. Elle meure entourée des siens. Au même moment, Juanita, majeure, doit quitter l’orphelinat pour aller travailler comme domestique dans une famille aisée. La vie hors des murs lui fait peur. Elle semble toujours traumatisée, paralysée par sa maltraitance au point d’être incapable de communiquer ne serait-ce que pour demander son chemin.
La tragédie des Oubliés de Clipperton est bel et bien une robinsonnade bien qu’elle ne s’en revendique pas viscéralement. Il y a finalement assez peu de références à Robinson dans ces quelques milliers de pages mises bout à bout.
C’est en tout cas un rameau bien vivant qui inspire régulièrement de nouveaux romanciers. Et j’ai sûrement été un peu sévère en affirmant la monotonie de ces romans. Quelle idée aussi d’enquiller ainsi les récits ?
Cette vie recluse en rappelle bien d’autres à commencer – le titre est suggestif – par Les oubliés de l’île Saint Paul. Je ne l’ai pas encore lu et je vous livre telle quelle la 4ème de couverture :
« Ils étaient nos parents ou nos grands-parents. Voulant s'affranchir d'une vie difficile et sans avenir, ils sont partis à la poursuite d'un rêve, celui de la fortune qui devait leur permettre une vie meilleure. Je vous offre de l'or, l'île de Saint-Paul pullule de langoustes, il suffit de se baisser pour les ramasser : quand, en 1928, René Brossière décide de coloniser l'île Saint-Paul, à quelque 13 000 kilomètres de la Bretagne, non loin des Kerguelen, il n'a aucune difficulté à convaincre quelques dizaines de Bretons de s'engager pour une saison de pêche. Comment résister à de telles sirènes ? Mais les promesses des recruteurs sont restées à quai. La réalité se révèle bien différente. Sur Saint-Paul, tout est à faire pour ces pionniers : la pêche elle-même, la construction d'une conserverie et celle des baraquements pour se loger. Les relations s'enveniment alors rapidement, d'autant plus que l'hiver n'offre guère de distractions : le paysage est désertique et le rocher battu par les tempêtes. Lorsque L’Austral, seul navire de l'île, quitte Saint-Paul, les quelques gardiens pensent qu'ils vont vivre une courte période d'isolement qui sera récompensée par un ravitaillement en produits frais. Mais les mois passent, l'hiver s'installe et L'Austral n'est toujours pas au rendez-vous. C'est l'enfer qui commence. La maladie - cette fois-ci le scorbut - frappe ces oubliés. Des sept Bretons demeurés dans l'île, abandonnés et sans secours durant neuf mois, quatre mourront, trois autres pourront être sauvés. La détermination de René Bossière n'est pourtant nullement entamée. Les tentatives suivantes se soldent par de nouveaux et dramatiques échecs. Saint-Paul, rêve englouti d'une pêche miraculeuse, fut pour les oubliés une terrible tragédie. »
Enfin - je m’y suis arrêté trop brièvement - cette publicité dont le leitmotiv est la réintroduction de l’homme dans la nature, illustrée par des panneaux montrant des hommes chauve-souris, des hommes-singes, des hommes ours-blancs…(Allez voir !) m’a suggéré des hommes-crabes, des hommes-fous. Des vrais. Parce que cette tragédie montre après tout l’inadaptation de la colonie privée de son cordon ombilicale qui le relie à sa mère civilisatrice.
Quelle vanité d’avoir pensé civiliser cette île ! Le génie humain est surfait ! Sa suprématie est battue en brèche ! Et c’est bien l’un des enjeux de la robinsonnade de rappeler d’abord l’extrême humilité de l’homme face à la nature. Non, il n’est pas omnipotent même si de trop nombreuses robinsonnades pourraient le laisser penser. Le corpus des robinsonnades oppose toujours les notions de culture et de nature. Il n’y a pas d’alternative, en tout cas dans la notre … de culture.